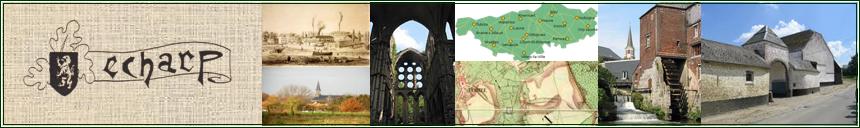
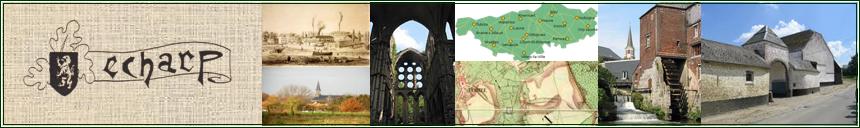


Les deux Thorembais doivent évidemment leur nom au ruisseau (bais, beek) qui sillonne leur territoire du sud au nord et auquel on a donné le nom banal de Grand-Ri ou Grand-Ruisseau; quant au préfixe Thorent, on pourrait le faire dériver du flamand toren, tour. Si nous ne craignions d'être accusés de chercher des étymologies hasardées, nous rappellerions ici Thor, l'une des divinités scandinaves; dans cette hypothèse, Thorembais signifierait le Ruisseau de Thor. On trouve : tantôt Thorenbaix (1172), Torenhais (1175, 1187, 1200, 1221, 1224, 1403), Thorenbais (1232 environ, 1267, 1403), Thorenbays (1422-1423) ou Tourenbais (1544-1545), en latin Torenbasium (1249); tantôt Torembais (1177, 1192, 1228, 1341, 1654-1656), Thorembais (1180), Torembays (1249, 1310) ou Thorembaix (1204), en latin Torembasium (1330); et tantôt encore Thorehais (1400-1461).
On pourrait considérer la désignation spéciale de Saint-Trond comme empruntée au patron de l'église; mais, d'après quelques documents, c'était saint Servais qui était le patron du temple. Il n'y avait aucun bénéfice, aucun autel dédié à saint Trond. Cependant l'ancienne désignation de la localité est bien précise; elle a commencé à être usitée dès le commencement du XIIIe siècle. On trouve : en latin, Torenbais S'ancti Trudonis (1240), Thorembasium Sancti Trudonis (1441), Torembaix Sancti Trudonis (1666); en français, Torembays le SaintTron (1339), Torembays Saint Tron (1374), Torenbays Sain tron (1383), Thourenbays le Sentron (1436), Thorebais Sain Thron (1439), Thorembais le Saintron (1449), Thorenbais le Saint Thron (1462), Torrebais le Sain tron (1469), Tourebais le Saint Tron (1492), Torembay Saint Tron (1545), Thorrebais lez Saint. Tron (1633), Torbaiz lez Saint Tron (16:56), Thorembais Sain Tron (LE ROY); Torembais Saint-Trond (1787); en flamand, Torrebaix ou Torrebais by Santron (1663, 1723).
Comme on a toujours ignoré la circonstance dont nous venons de parler (au sujet du patron de l'église), ce n'est que par une erreur flagrante, causée par la similitude des consonances, que l'on a pu placer à Thorembais-Saint-Trond le séjour des Centrones, l'un des peuples clients des Nerviens, d'après César.
Les Thorembais n'ont pas d'homonyme. L'histoire mentionne un château de Thorenborch, que le roi des Romains, Guillaume, comte de Hollande, éleva pour contenir les Frisons; ici la dérivation du mot toren, tour, est plus apparente. Le nom de la commune dont nous nous occupons se prononce en wallon. Torebaïe-Saint- Trond.
La commune de Thorembais-Saint-Trond est limitrophe de celles de Malève, Thorembais-les-Béguines, Perwez, Grand-Leez (Namur), Sauvenière (Namur). Tourinnes-les-Ourdons et Orbais.
Thorembais-Saint-Trond est à 2 kilomètres E. d'Orbais, 2 1/2i kilom. N.-O. de Perwez, 3 kilom. S. de Malève, 4 1/2 kilom. S.-O. de Thorembais-les-Béguines, 5 kilom. E. de Tourinnes, 7 1/2 kilom. N.-N.-E. de Grand-Leez, 8 1/2« kilom. N.-E. de Sauvenière, 39 kilom. E. de Nivelles, 40 1/2 kilom. S.-E. de Bruxelles.
L'église de Thorembais-Saint-Trond se trouve située par 56 grades 26 de latitude N. et 2 grades 72 de longitude E.
L'altitude du seuil de la porte de l'église est de 143 mètres 10.
Le procès-verbal de délimitation du territoire de Thorembais-Saint-Trond a été dressé le 10 avril 182» et clos le 29 août suivant. Le cadastre divise le territoire de Thorembais-Saint-Trond en trois sections : la section A ou de la Chaussée, la section B ou du Village, la section C ou des Cinq étoiles.
Au 1er janvier 1859, ces sections se trouvaient morcelées en 1,630 parcelles, appartenant à 477 propriétaires, donnant un revenu cadastral de 86,953 fr. 81 cent, (sol : 82,745 fr. 81; bâtiments : 4,208 fr. 00) et ayant une contenance de 1,372 hectares 16 ares 20 centiares (imposable : 1,336 hect. 83 a. 30 ca.; non imposable : 35 hect. 32 a. 90 ca.).
Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1834:

En 1686, Tliorembais-Saint-Trond comprenait 1,179 bonniers 2 journaux, dont 846 b. de terres, 35 b. 2 j. de prés, 34 b. de pâturages, 260 b. de bois et 4 b. de communaux.
On comptait : en 1374, 150 ménages; en 1436, 50 foyers; en 1464, 42 foyers; en 1472, foyers; en 1492, 22 foyers; en 1526, 27 maisons; en 1686, 37 maisons, 1 moulin et 3 tavernes; au 31 décembre 1856, 205 maisons.
Il n'y a dans la commune qu'une seule agglomération: le village de Thorembais, qui occupe la vallée du ruisseau dont il porte le nom. Le centre se trouve près de l'église, au bord de la route de Wavre vers Huy, non loin de l'endroit où elle est coupée par la route de Tirlemont à Charleroi. La partie méridionale du village, composée d'une soixantaine de maisons, s'appelle ordinairement le Ponceau.
A 600 mètres N. de l église , la Maison Kop, cabaret sur la route de Tirlemont; à 700 m. N.-N.-E., le Culot, écart qui se prolonge sur le territoire de Thorembais-les-Béguines; à 500 m. N.-E., la Ferme Gobart; à 3,700 m.S., la Maison Marchal, sur la chaussée romaine; a 3,800 m. S., Becnion, sur la chaussée romaine; à 1,500 m. S.-S.-O., Odvrenge, ferme (Ad Arengis ou Adarengis, 1165; Odebringhes, XIVe siècle; Odebrenges; 1374; Odebringes, 1323; Odebrenge, 1448, 1547; Odvrenge, 1530, 1624; Ville d'Oudeverenge, 1544-1545; Odenbringes, 1613; Oudebrenges, 1469, 1532, 1663; Odebrenges, 1562; Cense d'Odvenge, 1787); à 3,900 m. S.-S.-O., les Cinq étoiles (Aux cinq étoilles, 1763), écart à un carrefour de la chaussée romaine, où l'on voit une ferme en ruines; à 4,400 m. S.-S.-O., la Ferme du Battis (Cense du Baty, 1787); à 5,000 m. S.-S.-O., la Ferme du Long pont; à 2,900 m. S.-S.-O., la Ferme de Limelette-le-Bois ( Cense de Lymelet, 1544-1545; Vivier de Lymelet, 1544-1545); à à 1,700 m. S.-O., le Bois de Buis, auberge ; à 1,600 m. O.-S.-O., la Maison Stienne Paul; à 1,000 m. O.-S.-O., Bonne Espérance, écart dont la principale maison est l'Auberge Hanquet, sur 1a route de Tirlemont; à 1,500 m. O.-S.-O., la Maison André Paul, la dernière du hameau de Cochisse a Orbais; à 500 m. 0., l’Auberge Fabry ou Maison Vanpée; à 500 m. N.-O., Au Boulanger ou Au Gendarme, cabaret sur la route de Wavre; à 900 m. N.-N.-O., le Moulin de Thorembais ou Moulin du Philosophe, ainsi nommé parce qu'il a été bâti par un ancien élève de l'université de Louvain; à 400 m. N.-N.-O., les Trois pucelles, sur l'ancien chemin de Jodoigne.
Bois de Buis (Silva ou Bois de Buz, 1228, 1241, 1624; Bos de Bugs ou Buyse, 1624), ainsi nommé par corruption, car il ne s'y trouve point de buis et à Thorembais on prononce Bu, tandis que l'appellation wallonne de cet arbuste serait pauki (à cause de l'usage que l'on en fait aux Pâques fleuries); Bos Saint-André; Croix Faux, près de la borne 28 de la route, dans le bois de Buis, à l'endroit où un voiturier a été assassiné le 14 octobre 1818; Bois des Fourches; Fosse Maillet; Bois Béro; Chénedos; Chapelle a la Barre; Franc Préa; Cortil aux Saules; Tiége aux Poules (Trieu aux Poulles, 1679); la Marlière (Al Marlier de Bonne Espérance, 1679); Arbre Minguet; Champ du Minguet-, Champ du Moulin; Pré de Glatigny; Bosquet; Quatre bras, barrière au croisement des deux routes; Closière Jandrain; Pré des Ronsins; Moulin à eau ou Moulin Leurquin; Courte haie; Chapelle Saint-Arnaud; Champ Saint-Arnaud; Chapelle de Bonne Espérance; Champ de Bonne Espérance; Fond du Chéneau; Cortil Blaise; Grand pré ou Pré d'Odvrenge; Campagnette; Ruelle aux Fleurs; Camp des hussards; Ferme de Buret (Court de Bureit, qui appartenait au prince Antoine d'Arenberg; Ferme du Mont; la Commune; la Grosse pierre ou Grosse borne, à la rencontre des trois territoires de Thorembais-Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines et Perwez; Fontaine des Miracles; Longue vallée; les Curpiaux; Grande fagne et Petite fagne, prairies marécageuses; Bois Gonval; Champ Fauconval; Pâchis des Boeufs; Champeau (Champiaus, 1376; Champeaul, 1469, 1532, 1562, 1613; Ville de Champiau, 1544-1545; Champial, 1633; Champeal, 1440, 1663; Champoul, 1723); Pitance; Sart Pastiaux (Sart-Pasteau, 1686); Ruelle du Stade; les Trois frères, nom de trois chênes qui croissaient au bord de la chaussée romaine et que l'on a abattus en 1863; Cul d'Enfer; Taillis Madame; Champ de Limelette; Chemin de Jodoigne à Gembloux; Tiége de Gobart; Ruelle du Bois; Ruelle Dînant; Pont du Gouffre (del Goffe, en wallon); Chaussée Romaine; Pont de la Belle haie; Pont de Buret; Ferme Salmon; Ruelle du Clerc; Chemin du Mayeur; Buisson de la Longue vallée (A Longval, 1679); Chemin de la Procession; Pont des Buses; Pré Marais; Ruelle Carette; Tiége aux Saules; Pré Winant; Chapelle de Foi; Chapelle Gobart ou Sainte-Barbe.
La Blanche maison (1624); Vivier de Boulimeis (1544-1545); Bolimé (1592); Cortil de Bonne Espérance (1679); Prairie dite le Vivier des Cinq étoiles (1787) ; Al Fauconiere (XVIIe siècle); Prêt Flosch (1547); le Fier de Glymes (1547); Fief de Grosbecque (1624); Commune de la Fraiche Sarte (1787); Champaigne Guillaume Libiet et Chesne Guillaume Libiet (1624); Champaigne de la Haillette (1624); Maison Joseph (1787); Trieux de Long pont, 6 bonniers qui furent défrichés en 1780; Voie le Maistre 1449, 1450); Cortil Maroye Amand (1679) Al Vigne de Melemont (1547); Vaul ou Valee del Meez (XVIIe siècle); Vivier du Moulin (1547); En Mont, à Thorembais (1624, 1679); Al Piroy (1547); Jardin et Bosquet Pierson de Mont (1624); Bois d’Odvrange (1624); Vuariseau d'Odvrenge ( 1624); Preits d'Odvrenge (1624); Remboval ou Rembouval (1624, 1679); Al Saux Philippen (1624); la Saule Quaresme (1679); Vers la Tombelle (1624); Campagne delle Trouille (XVIIe siècle); Tiege Waernon (XVIIe siècle); Cense Warté (1787); Ruelle du Werischiet (1679).
Le territoire de Thorembais-Saint-Trond forme une vaste plaine, légèrement inclinée vers le N.-N.-E. Le point culminant se trouve à la lisière du bois de Buis, près de l'endroit où la route de Tirlemont à Charleroi pénètre dans la province de Namur; on y a constaté une altitude de 167 mètres.
L'étage inférieur du système gedinnien règne dans la vallée du Thorembais, qu'il remonte jusqu'au Ponceau, sous le limon hesbayen; il est représenté par du quartzite qui est a découvert près de la ferme Gobart, où l'on a ouvert une carrière. On a exploité, il y a une trentaine d'années, près du moulin à eau, un beau quartzite à gros grains hyalins gris, quelquefois bleuâtre, dont on faisait des pavés; la carrière, ayant été envahie par l'eau, a été abandonnée. André Dumont signale une autre carrière, qui aurait été ouverte anciennement à l'E. du moulin du Philosophe, près de la route de Tirlemont.
Le sol est constitué parle limon hesbayen; le sous-sol par les sables bruxelliens qui se montrent près du Culot et vers le moulin du Philosophe.
Toute la partie septentrionale du territoire de Thorembais-Saint-Trond appartient au bassin de l'Escaut; la partie méridionale, au bassin de la Meuse. La ligne de partage se trouve un peu au N. de la chaussée romaine et en suit la direction.
Le Thorembais et le Ri de la Belle Haie coulent dans le bassin de l'Escaut; L’Orneau, dans celui de la Meuse.
Le Thorembais ou Grand Ri ou Petite Gête prend sa source au Pâchis des Bœufs; entre a Perwez, près de la ferme de la Sarte; revient à Thorembais pour arroser les prés de la ferme d'Odvrenge; traverse le Ponceau et le village de Thorembais; passe sous la route de Wavre vers Huy; active le moulin Leurquin par une chute de 4 mètres 16; baigne la ferme Gobart et le Culot; devient limitrophe de Thorembais-los-Béguines; et coule exclusivement sur cette commune, après un parcours de 3,700 mètres, dont 200 mitoyens, dans la direction générale du N.-N.-E.
Le Ri de la Belle Haie prend sa source au Bois planté, près du Bois de Buis; devient limitrophe de Tourinnes-les-Ourdons; et cesse de l'être, près du Bois Saint-André, pour marquer la limite entre cette commune et celle d'Orbais, après un parcours de 1,400 mètres, dont 900 mitoyens, dans la direction du N. Depuis plusieurs années, ce ruisseau est presque constamment à sec.
L'Orneau, que l'on nomme aussi Gête, comme la plupart des ruisseaux des environs de Perwez, prend sa source à la lisière du bois de Floreffe, près de Becnion; coule à la limite de Grand-Leez, province de Namur; passe au pont du Gouffre, où il reçoit (r. dr.) les eaux des prés de la ferme du Battis; longe les prairies du Long-Pont et quitte Thorembais, au Sart-Pastiaux, pour servir de démarcation entre Grand-Leez et Sauvenière, après un parcours, entièrement mitoyen, de 2,300 mètres dans la direction générale de l'O.-S.-O.
Les fontaines dont l'eau sert aux habitants sont; la Fontaine Herpigny, la Fontaine du Battis, la Fontaine de Buret, la Fontaine Huart, la Fontaine Jacques, la Fontaine Grandmaître, la Fontaine Looze, la Fontaine Saintelet et la Fontaine du Ponceau.
Il y i un réservoir au moulin à eau et quelques mares dans les biens communaux. Le Vivier d’Odvrenge s'appelait parfois le Grand vivier d'Oderrenge, (Virarium magnum de Oderrenge, 1547); il méritait ce nom par son étendue, qui atteignait 12 bonniers en 1530, et il y avait alors sur ses digues un journal de bois. On mentionne aussi un Vivier de I.ymelet ou Limetette, pour l'achat duquel le marquis de Berglus avait ordonné (en 1544-1545) de donner tous les ans aux pauvres d'Oudeverenge 4 1/2 setiers de blé.
On comptait : en 1666, 240 communiants; en 1709, 283 habitants; en 1784, 547 habitants: 2 religieux, 112 hommes, 118 femmes, 68 garçons et 74 filles âgés de plus de 12 ans, 83 garçons et 90 filles âgés de moins de 12 ans (dans la paroisse, 530 personnes : 2 religieux, 181 hommes et garçons âgés de plus de 12 ans, 189 femmes et filles âgées de plus de 12 ans, 88 garçons ct 70 filles âgés de moins de 12 ans); en l'an XIII, 650 habitants; au 31 décembre 1831, 927 habitants; au 31 décembre 1856, 962 habitants (wallons). Les registres de l'état civil remontent : pour les naissances à 1604, pour les mariages à 1605, pour les décès à 1612.
Il existe a Thorembais un fort beau bois, où croissent un grand nombre de chênes, et dont la contenance est d'environ 130 hectares. On le nomme Bois de Buis. Jadis il comprenait toute la partie S.-O. de la commune, qu'il séparait de Sauvenière et de Sart à Walhain. Il s'étendait, en 1440, sur 300 b. 1 journal.
D'après les recensements généraux, les exploitations agricoles se classaient de la manière suivante par rapport a leur étendue :

Les exploitations de plus de 50 hectares sont actuellement : la Ferme de Limelette (137 hect.), tenue par M. Itlet (D.), appartenant à M. Crombez; la Ferme d'Odvrenge (134 hect.), tenue par M. De Bras, appartenant â M. Denis (Lonis); la Ferme du Battis (89 hect.), tenue par MM. Closet frères, appartenant eu usufruit à M. de Zualart de Louvain, en nue-propriété à MM. Desmanet de Biesme et consorts; la Ferme du long pont (75 hect.), tenue par 31. Everarts (Ph.), propriétaire. Le nombre des animaux domestiques constaté par les recensements généraux s'élevait à :

Les terres exploitées par les cultivateurs de la com-mune se répartissaient ainsi :

Ce chiffre total se subdivisait en biens exploités :

En moyenne l'hectare de terre était estimé à:

L'ancienne verge linéaire a 17 1/2 pieds de Louvain. I
Les seules usines sont deux moulins à farine, ayant chacun deux paires de meules et mus l'un par le vent, l'autre par l'eau. Ce dernier a une roue hydraulique activée par le Thorembais, dont la retenue est à l'altitude de 139 mètres 30; il constituait déjà, en 1440, l'un des quatre moulins banaux de la terre de Walhain. Le moulin à vent est de construction récente.
Il n'y a plus de brasserie qu'à Odvrenge, où elle travaille seulement pour les besoins de la ferme. Une grande partie des habitants s'occupent de la préparation du lin. Des ouvriers vont travailler, pendant la mauvaise saison, dans les houillères et les établissements métallurgiques du Hainaut.
Le chemin de fer de Tamines à Landen, encore en construction, traverse le territoire de Thorembais-Saint-Trond sur une longueur d'environ 2,300 mètres.
La route de l'Etat de Tirlemont à Charleroi traversé la commune sur 5,900 mètres; celle de Wavre vers Huy, sur 2,200 mètres. Une barrière est établie à leur intersection.
On compte 28 chemins et 30 sentiers vicinaux, mesurant ensemble 59,493 mètres, dont plus de 17,000 sont pavés.
Le chemin de grande communication n° 67 (allant de la route de Tirlemont à Charleroi vers Orbais) traverse Thorembais sur 783 mètres. Une barrière est établie sur le chemin n° 3 de l'Atlas de la voirie vicinale; la commune a été autorisée, par un arrêté royal en date du 10 novembre 1859, à y percevoir pendant dix ans un péage équivalant aux quatre dixièmes du droit perçu sur les routes de l'État.
La grande chaussée romaine de Bavay à Maestricht a un développement de 3,000 mètres sur Thorembais. Depuis longtemps les riverains avaient empiété sur cette antique voie; un arrêté royal du 17 février 1862 a consacré ce vandalisme en autorisant l'administration communale à réduire uniformément la chaussée de 10 à 6 mètres et à vendre l'excédant, soit 3 hectares 60 ares 8-1 centiares.
Le territoire de Thorembais-Saint-Trond est sillonné dans sa partie méridionale par la grande chaussée romaine de la Belgique, celle qui conduit de Bavai à Tongres. Les antiquités abondent le long de cette voie qui, en quelques places, est encore assez bien conservée. A l'endroit où elle borde le bois de Buis, à 250 m. environ de la chaussée de Charleroi à Tirlemont et a 800 m. N.-E. du point où elle coupe cette route, il existe un tumulus qui a 2 m. de hauteur et 40 m. de circonférence; il ne le distingue pas sans peine parce qu'il est entièrement couvert de jeunes arbres; deux autres tumulus, plus petits, l'accompagnaient jadis. En plantant le taillis, il y a environ sept ans, un ouvrier a trouvé, à la profondeur d'un mètre, une épée à double tranchant, longue de 74 centimètres avec la soie, large de 23 millimètres vers la garde et entièrement rongée par la rouille. En bêchant la terre au pied du tumulus, on a découvert une espèce de pavement en pierres de sable. Au N.-E. et à près de 100 m. de ce monticule, en continuant à suivre la chaussée romaine, des débris de tuiles, de briques, de ciment se présentent si nombreux que l'on peut, sans hésiter, admettre l'existence de constructions en cet endroit.
On a trouvé dans le bois de Buis, à 150 m. E. de la borne 28 sur la route de Tirlemont, dans la direction de la ferme de Limelette, des fragments de meule de moulin et de tuiles romaines, ainsi que des fondements en briques. A 350 m. S.-O. de la même borne, débouche au côté 0. de la route un sentier marqué du n° 7; en le suivant sur une longueur de 160 mètres, on rencontre un carré d'environ un hectare entouré, de fossés énormes, où l'on a trouvé des fragments de tuiles romaines, des fondements et des débris de matériaux. Cet emplacement s'appelle le Taillis del Vieil Limelette, ce qui pourrait faire supposer que la ferme de Limelette a d'abord existé en cet endroit. Au bord de la route de Wavre vers Huy, près de l'église, on remarque un énorme bloc de grès, qui a environ 1 mètre 70 de long, 0,25 de large et 0,75 de hauteur, en dehors du sol. Ce curieux monolithe était placé jadis à l'angle du mur du cimetière.
En 1422-1423, Godefroid de Brabant, bailli de la terre de Walhain, fit arrêter à Thorembais deux jeunes gens, deux frères, et les fit emprisonner dans le château de Walhain. Les parents des prisonniers réclamèrent énergiquement pour qu'on les renvoyât à Thorembais et qu'on les y jugeât; agir autrement, d'après eux, c'était violer les lois du pays. La ville de Louvain, dont on suivait la coutume dans le village, insista vainement en leur faveur; lorsque le bailli céda enfin, l'arrestation des deux frères leur avait coûté plus de 100 florins. Cité par devant les échevins de Louvain, Godefroid fut condamné à aller en pèlerinage à Rome (ou à payer une amende de 10 couronnes, valant 74 sous 8 deniers de gros) et déclaré inhabile a remplir un emploi.
Dans une visite épiscopale de l'année 1666, on raconte sérieusement qu'il se trouvait â Thorembais 28 possédées; lorsqu'on les exorcisait, elles criaient comme des énergumènes et se démenaient tellement que les assistants pouvaient à peine les contenir. Quelques-unes d'entre elles furent soupçonnées et accusées de sortilège; quand les autres approchaient d'elles ou mangeaient du même pain, elles donnaient également des symptômes d'exaltation ou d'abattement. La plupart, dit une note marginale, furent délivrées du démon et quelques unes brûlées. La tradition n'a pas perdu tout souvenir de ces cruelles exécutions : une sorcière a, dit-on, été dévorée par le feu au chemin qui fait la séparation de Thorembais ct de Perwez, à la Grosse pierre ou Grosse borne.
Le typhus a fait des victimes en 1858 et 1859. Cette maladie règne fréquemment dans plusieurs localités du canton de Perwez, qui sont situées sur le vaste plateau où se rejoignent les bassins de l'Escaut et de la Dyle et où les ruisseaux n'ont qu'une pente très faible.
Thorembais-Saint-Trond ressortissait, sous l'ancien régime, à la mairie d'Incourt; depuis l'an III, il dépend du canton de Perwez.
La justice à tous les degrés y appartenait au seigneur de Walhain. On y suivait la coutume de Louvain. Les échevins se qualifiaient parfois d'échevins de la haute cour de Thorembais-Saint-Trond. Ils se servaient, en 1644, d'un sceau où l'on voyait un jeune homme couvert de longs vêtements, tenant de chaque main un écusson aux armes des Berghes; la légende portait : TO(REM)BESII STI.TRUDONIS
Le greffe, à partir de l'année 1608, existe aux Archives du royaume. Comme indice du peu d'instruction qu'il y avait dans nos campagnes, au siècle dernier, nous citerons ce fait qu'en 1767, sur cinq échevins, deux déclarèrent ne savoir écrire.
En 1374, le village, sous le rapport des aides, comprenait la partie du village d'Orbais obéissant au seigneur d'Agimont (possesseur de Walhain), une partie de Malève et des hameaux de Glatigny et de Cocquiamont (ces derniers dépendant de Thorembais les-Béguines). C'est ce qui explique le grand nombre de ménages que le recensement de cette année lui attribue.
La commune possède 10 hectares. Son budget, pour 1859, présente les chiffres suivants :

Les Orbais furent les premiers seigneurs de Thorembais-Saint-Trond. C'était de l'un d'eux, Enguerrand d'Orbais, que Gosuin d'Havré et Lambert de Notengien ou Nosseghein ( entre Bruxelles et Louvain) tenaient en fief l'église du village, qui était tenue de ceux-ci par plusieurs particuliers : Wicard de Thorembais, Gosuin de Turnines ou Tourinnes et Mathilde de Lérinnes. En 1172, ces trois particuliers et leurs enfants, du consentement de leurs suzerains immédiats et de leur seigneur supérieur, cédèrent leurs droits sur cette église à l'abbaye de Bonne-Espérance, moyennant une rente annuelle de 20 deniers de Namur. Les prêtres du concile ou doyenné de Jodoigne donnèrent leur assentiment à cet acte, qui s'accomplit eu présence d'un grand nombre de chevaliers, dont plusieurs se qualifiaient d'hommes libres.
Les seigneurs de Perwez, qui descendaient d'Enguerrand par les femmes, conservèrent des vassaux â Thorembais, et, dans le nombre, Egide de Lérinnes, le fondateur du couvent de ce nombre. En 1240, le dimanche après la fête des saints Philippe et Jacques, Godefroid de Perwez, à la demande de sa femme Aëlide, renonça, en faveur du couvent, à tout le fief qu'Égide relevait de lui à Thorembais-Saint-Trond.
Il semble que les possessions des Perwez passèrent en partie aux Walhain, peut-être â la suite d'une alliance matrimoniale. Au XVe siècle nous voyons les registres aux reliefs de la cour féodale de Brabant comprendre dans la terre de Walhain : « Torrebais le Sain Tron, Oudebrenges et Cbampeaul, avec haute et basse justice, maire, échevins, serviteurs, quatre moulins bannaux, quatre brasseries franches, des étangs, des bois, des cens, des rentes, des hommage, des censives » (reliefs du 3 août 1532, du 31 décembre 1562, du 30 décembre 1613). Ces quatre moulins, ces quatre brasseries étaient des annexes de la terre de Walhain tout entière et non du village de Thorembais en particulier; c'est une erreur qui s'est introduite à la longue et qu'il est facile de redresser en examinant le dénombrement fait par Antoine de Glimes le 4 août 1440. Les seigneurs de Walhain levaient à Thorembais un sixième de la dîme; ils y avaient deux échevinages, un dans le centre du village et un dit d'Oudeverenge. Chacune de ces cours recevait d'eux 15 sous par an. Le sergent de Thorembais et l'hôte (de la taverne banale de ce village) avaient chacun une poule, pour émoluments.
En 1544-1545, le cens seigneurial à Thorembais valait 48 sous 4 1/2 deniers, plus 39 s. 7 d. payables à la Saint-Denis, 16 sous 1 d. payables à la Saint-Étienne, 67 s. 7 d. payables au jour des Rois. 2 livres 7 s. 7d. payables à la Saint-Jean, 10 1/2 muids d'avoine, 58 1/3 chapons. La taverne banale payait 3 livres 10 s.; le moulin banal 9 muids de seigle.
Le cens de la « ville d'Oudeverenge » produisait 18 s. 14 d., plus 29 s. 2d. payables à la Saint-André, 6 s. 2 d. payables à la Saint-Etienne, 19 s. 5 d. payables à la Saint-Jean, 31 muids 1 setier d'avoine et 20 chapons.
Champiau ou Champeau formait une seigneurie distincte, dont le cens valait 38 s. 1 d. et 16 chapons. En 1376, les maire et échevins du seigneur de Walhain en la cour de Champiaus passaient leurs actes en forme de chirographes.
La ferme de Limelette, qui forme encore une annexe du domaine de Walhain, était louée, en 1544-1545, moyennant 46 livres d'Artois, 10 muids de froment, 46 muids de seigle, 15 muids d'avoine, mesure de Gembloux, et 1,200 gerbes de paille, et avec l'obligation d'amender tous les ans par de la marne une partie de terres et de payer les ouvriers à raison d'un sou par jour. Le fermier recevait, par an, un muid de blé et deux griffons, et, tous les deux ans, une robe ou habit. Cette ferme a probablement été la résidence d'une famille de chevaliers ou peut-être l'une des propriétés des seigneurs de Limelette près d'Ottignies, car nous voyons un « sire Henri de Limelette » figurer parmi les vassaux du sire Godefroid de Perwez, en 1240.
Le bois de Buis doit peut-être à la même cause la dénomination sous laquelle il est connu. En 1190, un Gillaume Bus figure parmi les vassaux du duc Henri Ier.
Les premières chartes qui nous parlent de Thorembais citent des chevaliers de ce nom, tels que : Wicard de Thorembais, l'un des possesseurs de l'église en 1172; Gosuin de Thorenbaix, également en 1172; Marsilius de Thorembais, en 1225; Jacquemon de Thorembaix, en 12641.
Plus tard, il exista une seigneurie foncière de Buret. La ferme de ce nom existe encore, à 300 m. environ au S. de l'église; quant au manoir, il occupait, dit-on, une prairie et un jardin adjacents, appartenant aujourd'hui au duc Antoine d'Arenberg. La famille du Mont de Buret, qui a compté de très belles alliances, a eu pour chefs successifs, d'après les généalogistes :
Jean du Monut, fils de Godefroid, châtelain de Jodoigne;
Gilles, mort en 1549;
Jean, qui fut créé chevalier par le roi Philippe II, lors de son couronnement à Londres, en qualité de roi d'Angleterre, et qui, en testant, en 1592, avec sa femme, Anne Bernard, légua une redevance annuelle d'un muid de blé à la cure et à l'église. Son frère Gilles fut gardien des récollets de Louvain, puis provincial de la province teutonique, et enfin évêque de Deventer, en vertu de lettres patentes du 23 octobre 1570; il mourut à Zwolle, après une administration très difficile, le 26 mai 1576. Deux fils du seigneur de Buret se distinguèrent d'une manière bien différente : Antoine, capitaine, combattit vaillamment lors des sièges d'Armentières et de la Bassée par les Français; Gilles devint vicaire général de l'évêché de Deventer, puis doyen de la collégiale de Lierre;
Jean, gentilhomme de l'artillerie du roi d'Espagne;
Jean, quartier-maître de cavalerie au régiment du prince de Ligne;
Jean-François, seigneur de Buret par relief du 29 août 1646;
Paul-Jean-François, seigneur de Franquenies (à Mousty), par alliance, mort le 22 juin 1734;
Joseph-Nicolas du Mont, mort en célibat le 7 avril 1755, le dernier de sa branche.
En 1323, on mentionne René et Pierre d'Odewringes, fils de Sohier de Jacelete dit du Sart. La ferme d'Odvrenge payait encore à la marguillerie de Perwez, en 1787, une rente de 2 1/2 deniers (1 fl. 16 s.) pour les anniversaires d'Etienne d'Odvrenge et de son fils; de Godefroid du Fresne, de Jean Evrard, d'Isabelle, sa femme, et de Jean du Mont. Celui-ci, qui était fils de Jean du Mont, le premier seigneur connu de Buret, fut châtelain de Genappe, et laissa le bien d'Odvrenge à ses fils Jean et Rase. Le premier fut père de Mathieu, aïeul de Jean, et bisaïeul d'Antoine, dont le fils, Jean-Antoine, vivait à la fin du XVIIe siècle; le second fut père de Jean, qui força à deux reprises les Hollandais â lever le siège du fort de Nassau, dont il était le commandant; aïeul de François, capitaine d'infanterie, et bisaïeul de François, qui obtint, le 10 janvier 16-12, une déclaration d'ancienne noblesse.
L'abbaye de Gembloux possédait originairement une partie du Bois de Buis; elle en céda 65 bonniers au seigneur de Walhain, à la condition de conserver le droit d'y lever la dîme et la quatrième gerbe. Au mois de septembre 1333, le monastère de Bonne-Espérance céda à celui de Gembloux, en échange de la dime de Souvret, une moitié du tiers de la dîme qui était annexé â la cure; l'autre moitié resta au curé, grevée de toutes les charges ordinaires des décimateurs. En 1793, la seconde des abbayes précitées levait encore le sixième de la dîme, qui produisait 355 florins.
Dans la fraction du village qui dépendait de la paroisse de Perwez, la dîme appartenait : à Heylissem, dans le canton dit de Limelette, qui comprenait 307 b. 3 j. de terres, 27 b. de prés et 35 b. de bois, et, au bénéfice castral de Perwez, dans le canton des Cinq-Étoiles, qui s'étendait sur 96 b. 3j. de terres, 10 b. 1 j. de prés, 2 b. 3 j. de bois et 1 b. de communaux. La communauté d'Heylissem avait pris en engagère, en l'an 1165, d'Enguerrand d'Orbais, les dîmes de Seumay et d'Odvrenge, moyennant 12 marcs, qu'Enguerrand seul avait le droit de rembourser. Cette dîme, non plus que celle du seigneur de Walhain, n'était assujettie aux charges ordinaires.
Le prieuré d'Auderghem, près de Bruxelles, qui fut supprimé en 1784, par le gouvernement autrichien, prélevait la moitié des dîmes de Thorembais, probablement en vertu d'une donation faite par l'une des dames de Perwez, dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
L'église de Thorembais-Saint-Trond avait jadis saint Servais pour patron. Elle avait rang d'église médiane (selon un pouillé du diocèse de Namur, c'était une église entière). Elle fit partie du doyenné de Jodoigne, tant lorsqu'elle dépendait de l'évêché de Liège qu'après la création de l'évêché de Namur. Après le concordat, elle devint une succursale de la cure de Perwez. Jadis, la paroisse ne comprenait pas toute la commune; les cantons de dîme dits de Limelette ou d'Odvrenge et des Cinq étoiles faisaient partie de la paroisse de Perwez.
La cure, dont la collation appartenait, depuis l'an 1172, à l'abbaye de Bonne-Espérance, qui y envoyait comme desservant un religieux, jouissait, en 1666, de la dotation des chapellenies fondées dans l'église. Une sentence du conseil de Brabant du 2 septembre 1712 fixa la compétence que l'abbaye avait à payer au curé à 350 florins, et une décision épiscopale, du 20 février 1718, en éleva le taux à 135 écus. En 1787, les fonctions de curé valaient 1,070 fl., dont 281 provenant d'un sixième de la dîme, 20 provenant de quelques novales, 107 fl 2 s. provenant de la menue dîme; le curé jouissait, outre sa cure, de 33 bonniers de terres et de prés et d'un journal de bois. La cure fut achetée, le 27 septembre 1595, par le curé Adrien Simon. Nous voyons qu'en 1706 elle était inhabitable et menaçait de crouler, comme l'attestent deux déclarations, émanées : l'une, des maire et échevins (du 14 septembre), l'autre, du charpentier Simon de Houssoit et du maçon Pierre du Pont (17 septembre). L'abbaye de Bonne-Espérance fut condamnée, le 10 octobre 1733, à la rebâtir et, le 1er avril 1775, on en adjugea de nouveau la reconstruction.
La chapellenie de Saint-Nicolas ne possédait que deux bonniers de terres et était chargée d'une messe par semaine; elle fut réunie à la cure à cause de la modicité de ses revenus. Quant à celle de Sainte-Marie-Madeleine, elle fut probablement fondée par les habitants du village, car, vers l'an 1250, ils la conférèrent à un prêtre nommé Etienne; l'abbaye de Bonne-Espérance ayant élevé à ce sujet des réclamations, Etienne céda au monastère tous les droits qu'il avait à la possession du bénéfice, par-devant maître Hugues de Wellin, chanoine de Cambrai, qui avait été chargé par le pape déjuger ce conflit (acte en date du jeudi avant la fête des saints Simon et Jude, en 1257), et, plus tard, le village renonça également, au profit de l'abbaye, à tout droit de collation. Par un acte du 17 mars 1631, l'évêque de Namur consentit à ce que cette chapellenie fut transformée en marguillerie; puis, on l'annexa également à la cure. Elle possédait Il b. 3 j. de terres et était chargée de 2 messes par semaine.
La marguillerie, en vertu d'un don de la comtesse de Marsan, prélevait, en 1787, à titre de compétence, la dîme sur 37 à 38 b. de terres (produit, 130 fl.) et avait un revenu total de 208 fl. 10 s. Les biens de la fabrique consistaient alors en 7 b. 1 j.; ils ne comprennent aujourd'hui que 2 hect. 20 ares; ses revenus s'élevaient : en 1787, à 156 fl. 10 s.; en 1840, à 617 francs.
En 1666, le cimetière était mal fermé et le bétail y venait parfois pâturer; le mur à l'angle des asseintes ou bas-côtés tombait en ruines; il y avait dans le chœur une stalle qui gênait la circulation. En 1757, l'édifice fut reconstruit sous la direction du curé d'Orbais, Buisseret. La vieille tour croula à cette époque et, dans sa chute, endommagea considérablement le mur du cimetière. Bientôt des plaintes s'élevèrent sur l'insuffisance du nouveau temple. Il n'avait, disaient les paroissiens, que 40 1/2 pieds de long sur 27 1/2 de large et ne suffisait pas à contenir le quart des personnes de la paroisse âgées de plus de sept ans et dont le nombre s'élevait à 300; lorsqu'on l'avait élevé, ajoutaient-ils, on n'avait pas suivi le plan décrété par le conseil de Brabant. Ordre fut donné par ce corps à l'architecte Wincqz, de se joindre aux commissaires chargés d'examiner l'état de l'église et aux habitants de se réunir tous dans cet édifice, afin d'en constater l'insuffisance, puis, par une sentence assez singulière, puisqu'elle n'est pas basée sur les conclusions des parties, le conseil enjoignit aux décimateurs, l'abbaye de Bonne-Espérance et le prieuré d'Auderghem, d'établir un vicaire à Thorembais-Saint-Trond et de lui assigner une compétence de 240 fl. par an (29 février 1780). La même année Bonne-Espérance fut condamnée à supporter seule cette charge, mais elle parvint à s'en débarrasser et à l'imposer au curé et aux habitants; par contre, il est vrai, elle édifia, en 1785-1787, une nouvelle église, sur les plans de l'architecte Nivoy. La dépense totale monta à 6,266 fl.; Nivoy reçut pour émoluments 302 fl. 8 sous.
Comme on peut le conjecturer sans l'avoir vue, l'église n'a rien de remarquable sous le rapport de l'art. Elle est précédée d'une grosse tour carrée, en briques à sa partie supérieure, qui est recouverte d'une pyramide ardoisée à quatre pans; c'est tout ce qui subsiste d'antérieur aux travaux effectués en 1757. A l'intérieur, l'église n'a qu'une nef, assez large, recouverte d'un plafond cintré en berceau surbaissé; le chœur se termine par un mur plat. Le maître-autel et les confessionnaux proviennent de Lérinnes et ont été donnés par le gouvernement autrichien après la suppression de ce couvent. On a conservé la base de l'ancien baptistère, qui était à peu près semblable à celui de Sart-lez-Walhain. L'ancienne cloche décimale avait été fondue, en 1721, par Jacques Feraille, de Namur, pour 130 fl. 10 1/2 sous.
Sur une dalle du pavement, représentant un squelette, avec les attributs des évangélistes aux quatre angles de la pierre, on lit cette inscription : « Cy . gist. Baes. Du mo(n)t | en. son . te(m)ps . maieur de. Tore(m)bais . St . Trond . Quy . | trespassa . e(n) . la(n) . de . grâce . | MVe'LVIIJ . le . XJ°. jour, de . Jullet. pries . pour . son. ame | Auionrdhuy . Moy . demain . vous » .
Ces attributs des évangélistes sont reproduits, dans un quartefeuille, aux extrémités d'une croix posée au jubé. Une autre dalle tumulaire est placée extérieurement, devant la porte de l'église; file représente deux personnages, mais l'inscription a été entièrement effacée par le frottement des pieds.
Au bord de la route de Tirlemont à Charleroy s'élève une grande chapelle octogone, sur laquelle on lit l'inscription : D O M | Chapelle dédiée à Notre-Dame de | Bonne espérance édifiée par les | épargnés de mr Potvin rd curé | dorbais défunt et par les soins et | frais de mr Mormal | curé de | Thorembais saint Trond . l'an 1820 | VI . M . l . D . ILI . VCCV . L . I.
La Table des pauvres était jadis double : il y en avait une à Thorembais et une autre à Odvrenge. La première, à laquelle la seconde a sans doute été réunie, possédait : en 1787,18 b. de terres et un revenu total de 505 fl. 16 s. Actuellement, la dotation du bureau de bienfaisance comprend 15 hect. 70 ares.
Son budget , pour l'année 1859, a été fixé comme suit :

En 1666, l'école était presque complètement détruite et peu d'enfants la fréquentaient. Une école communale, avec logement pour l'instituteur et chambre commune, a été bâtie en 1819. Le nombre des enfants pauvres qui ont été admis par la commune, en 1858-1859, à recevoir l'instruction, s'est élevé à 119: 68 garçons et 51 filles.
Il y a à Thorembais une société musicale.
La fête principale se célèbre le premier dimanche de mai; la petite fête, le dimanche après le 24 novembre, jour de Saint-Trond.
On donne Perwez pour patrie à Pierre Du Mont de Buret; mais, selon toute apparence, ce théologien naquit à Thorembais-Saint-Trond, village qui a été le séjour ordinaire des du Mont, et dont une partie, comme nous l'avons dit, ressortissait jadis à la paroisse de Perwez, notamment la ferme d'Odvrenge, l'une des possessions des du Mont. Pierre naquit de Pierre du Mont, mort en 1501, et de Catherine Neix; il fut nommé recteur de l'université de Louvain en 1542, entra ensuite dans l'ordre des Récollets, était gardien du couvent d'Anvers lorsqu'il fut expulsé de cette ville par les calvinistes en 1578, et mourut à Louvain le 20 avril 1579.

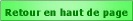
 |
Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon |

